|
Dominique Potier |
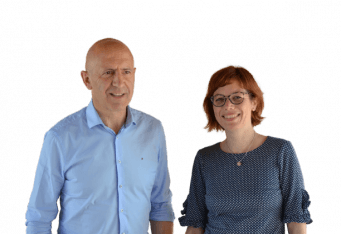 |
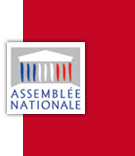 |
 |
 |
 |
 |
Vidéo à la une
Agenda
Mardi 10 mars
Détail de la journéeEn circonscription
|
| NEWSLETTER Restez informés des actualités de Dominique Potier en vous inscrivant à la newsletter |
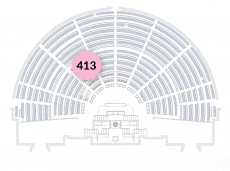
> L'activité de votre député sur le site citoyen NosDéputés.fr
contactPermanence parlementaire
27 avenue du Maréchal Foch
54200 TOUL
Tel : 03 83 64 09 99
Fax : 03 83 64 31 05
Nous écrire
Actualités
Un an après... Comment penser ''en même temps'' la fin du tragique dans la NRF et celle de l'exit tax dans Forbes ?

Comme un antidote à l'amnésie ou à l'anachronisme je vous invite à relire ce grand article de Laurent de Briey qui ouvre 3 perspectives :
- s'affranchir de la mise en scène stérile de l'opposition entre une idéologie bien-pensante et une autre archaïque voir totalitaire.
- refonder l'action politique sur la quête de sens plutôt que sur l'effervescence
- penser la sortie de l'individualisme libéral et le passage d'une société de marché à une société civique.
Prospérité et crise du politique
Laurent de Briey (Université de Namur)
« Prospérité ». Le terme n'est guère aisé à définir même formellement. Il évoque un état favorable, un réel épanouissement, une certaine abondance, un assouvissement des besoins à tout le moins. Il s'oppose à la misère, voire au marasme. Sans autre précision, nous tendons aujourd'hui à lui donner une connotation économique ou, plus largement, matérielle. Mais sans doute est-ce déjà là une interprétation particulière de la prospérité et est-il également possible de parler de prospérité culturelle, religieuse, voire morale ou politique.
Dans le cadre de cet article, je privilégierai en tout cas une définition large de la prospérité comme étant la finalité du développement. Non pas que la prospérité en constitue le terme – le développement est un processus continu, il n'y a donc guère de sens de parler de son terme –, mais elle représente ce qui est recherché dans le développement. Il ne s'agit là, toutefois, que d'une définition formelle. Elle demande à être précisée en qualifiant le développement en question. Vouloir définir la prospérité signifie donc s'interroger sur le mode de développement poursuivi collectivement. Une définition de la prospérité n'est donc pas seulement une question technique portant sur le choix d'un indicateur de développement. À travers la définition de la prospérité, c'est une conception de ce qui constitue le progrès social que l'on essaie d'imaginer. En ce sens, la définition de la prospérité me semble constituer une tâche fondamentalement politique.
C'est pourquoi la présente contribution resitue la question de la définition de la prospérité dans le cadre de la crise du politique dont la figure centrale et institutionnalisée, l'État, est aujourd'hui fragilisée dans ses missions fondamentales. Je montrerai que cette crise du politique trouve sa source, d'une part dans la périphérisation de l'État induite par la mondialisation, et d'autre part dans la généralisation de l'individualisme libéral qui, au nom de l'émancipation et de l'autonomie, disqualifie l'affirmation de valeurs collectives (section 1). S'impose alors une réduction du politique au modèle de la gouvernance. Ce modèle restreint la légitimité de l'État à la seule efficacité de la gestion et de la production des ressources économiques, au détriment de la formation collective d'un projet de société (section 2).
Cette réduction du politique exclut la définition des valeurs collectives de sa sphère de compétence au profit d'une dérégulation morale. Cette dérégulation reposant sur le même individualisme que la dérégulation économique, je me demanderai si elle ne favorise pas davantage la colonisation économique de la culture que l'autonomie individuelle (section 3). Une véritable valorisation de l'autonomie doit intégrer une responsabilisation des personnes quant aux effets de leurs actions sur les autres et requiert un ethos social fondé sur un sentiment d'appartenance à un même projet : rendre la société plus prospère (section 4).
Devrait ainsi être réaffirmé le sens du politique en tant que pouvoir d'imagination d'une prospérité poursuivie collectivement et qui ne soit pas d'emblée restreinte à la seule question de la répartition des ressources, mais prenne également en compte l'affirmation de valeurs promues collectivement (section 5). La conclusion de cette contribution sera ainsi que la prise de conscience de la nécessité d'une définition politique de la prospérité participe à la prospérité politique – l'opposé donc de la misère politique. Cette prospérité est comprise comme un niveau de développement du système politique correspondant à un exercice jugé efficace et adéquat de l'ensemble de ses fonctions et s'exprimant dans la confiance des citoyens envers des institutions et des représentants dans lesquels ils se reconnaissent (section 6).
Faute de place, il ne sera pas toujours possible de démontrer ces différentes thèses de manière systématique – cela a d'ailleurs, bien souvent, déjà été fait ailleurs. L'ambition de cet article est plutôt d'esquisser la cohérence globale de leur enchaînement. À cette fin, je m'appuierai de manière privilégiée sur les livres de Jacques Généreux, La Dissociété, et Bernard Stiegler,
La Télécratie contre la démocratie, et sur les résultats de certaines de mes recherches antérieures, tout particulièrement sur l'ouvrage Le Sens du politique dont je synthétiserai certains arguments.
1. La crise du politique
Le modèle idéal-typique classique du politique est celui de l'État-nation. L'État y est perçu comme une autorité centrale souveraine, c'est-à-dire dotée du pouvoir d'édicter les normes et les règles régissant les relations sociales au sein d'une communauté donnée. Cette communauté forme une nation qui se caractérise par une forte homogénéité culturelle et morale qui, bien loin d'être naturelle, résulte d'une construction politique délibérée, s'appuyant notamment sur l'instruction obligatoire, afin d'assimiler les minorités.
La persistance de ce modèle dans l'imaginaire collectif transparaît dans la métaphore de l'île – ou du vaisseau spatial – à laquelle aiment parfois recourir les philosophes politiques. Cette métaphore leur permet de penser les principes de justice devant régir une société fermée sur elle-même et de réserver, pour un deuxième temps de leur réflexion – lorsqu'ils découvrent que l'île fait partie d'un archipel –, la question des rapports entre les États. Cette représentation de l'État doit cependant être désormais considérée comme une source de confusions nous empêchant de percevoir la « périphérisation » de l'État provoquée par la globalisation et la cosmopolitisation de la réalité qu'elle induit.
La cosmopolitisation consiste en l'intégration des personnes au sein d'une communauté humaine globale, par-delà leurs différences nationales, religieuses, ethniques, sociales et culturelles. La mobilité sous toutes ses formes (mobilité des biens, des personnes, des capitaux, de l'information, etc.) d'une part, et le développement de risques affectant l'ensemble de la planète (réchauffement climatique, cataclysme nucléaire, terrorisme international, modifications génétiques, etc.) d'autre part, rendent caduc le niveau étatique ou national comme référence principale de la réflexion. La souveraineté s'est effacée au profit d'une interdépendance sans cesse croissante des personnes et des États. Ces derniers ne sont plus des autorités centrales singulières, dotées du monopole de la violence légitime, mais constituent des acteurs particuliers insérés dans des interactions globales avec des acteurs aussi divers que d'autres États, des institutions internationales, des multinationales, des ONG… Cette « périphérisation » des États les affecte dans l'exécution de leurs trois fonctions traditionnelles : 1) le maintien de la sécurité intérieure et extérieure ; 2) le contrôle des équilibres macroéconomiques ; 3) le renforcement de la cohésion sociale (Vercauteren, 2001 : 293-315).
Le maintien de la sécurité, intérieure comme extérieure, ne peut aujourd'hui être assuré que moyennant une coopération transnationale affectant l'État dans le symbole premier de sa souveraineté. Les États-Unis doivent rechercher un appui international lorsqu'ils souhaitent entreprendre une opération militaire d'envergure. Même lorsqu'un tel appui n'est pas nécessaire sur le plan technique, il est indispensable afin de conforter la légitimité de l'opération entreprise et d'espérer bénéficier d'un soutien intérieur suffisamment fort pour pouvoir en assumer les coûts humains et économiques. Les États ne peuvent conserver une capacité d'action que s'ils reconnaissent la réalité de leur interdépendance et qu'ils prennent conscience qu'ils ne peuvent servir leurs intérêts nationaux qu'en poursuivant des intérêts communs.
L'intégration progressive des économies nationales en une seule économie mondiale au cours des quarante dernières années ne s'étant pas accompagnée d'une intégration politique analogue, les États ont également vu se réduire leur capacité de régulation de l'économie. Que la dérégulation des marchés – qui a rendu possible la mondialisation économique et financière – n'ait pas été subie, mais provoquée par certains États (l'Angleterre de Thatcher et les États-Unis de Reagan, tout particulièrement, même si les États-Unis ont essentiellement favorisé la dérégulation dans les autres pays) n'est guère contestable (Généreux, 2008 : 63-68), mais une fois le processus enclenché, les États se retrouvent engoncés dans une logique de compétitivité par rapport à laquelle ils n'ont, isolément, que peu de marge de manoeuvre. Les différents États sont incités à réduire les charges sociales, la fiscalité et les salaires au profit de la rémunération du capital. Les États se retrouvent ainsi engagés dans une situation « lose-lose », dans la mesure où ils sont contraints d'aligner leur comportement sur celui de leur voisin non pour augmenter leur compétitivité, mais afin de la préserver.
Ce déficit de contrôle par l'État du système économique ne signifie toutefois pas que l'État ait perdu tout rôle économique. Au contraire, l'économie est devenue la préoccupation pratiquement exclusive du politique, à mesure que le rapport de subordination entre ces deux instances s'est inversé. Puisque le politique n'est plus à même de subordonner les relations économiques à un cadre normatif qu'il détermine, c'est lui qui est désormais subordonné aux contraintes économiques et qui se voit attribuer comme finalité la préservation de la compétitivité économique. Mais, ce faisant, c'est la troisième fonction de l'État – le renforcement de la cohésion sociale – qui apparaît à son tour en crise.
L'enjeu du renforcement de la cohésion sociale n'est pas seulement relatif aux inégalités socio-économiques. Il renvoie plus largement à la capacité de créer un sentiment collectif d'appartenance à une même société, de définir une identité collective et de donner ainsi un sens au vivre-ensemble. Il y a cohésion sociale lorsque les membres de la société estiment être inclus dans la réalisation d'un projet commun. Le renforcement de la cohésion sociale passe donc par la lutte contre les inégalités génératrices d'un sentiment d'exclusion sociale ; il exige également l'élaboration collective d'un projet dans lequel les citoyens se reconnaissent.
Or les contraintes propres à l'exigence de compétitivité économique font pression à la baisse sur les mécanismes de solidarités interpersonnelles. Il en résulte une hausse des inégalités socio-économiques et de l'exclusion sociale. Mais la cohésion sociale est également
fragilisée par les aspects culturels de la mondialisation. Sous le double effet de la sécularisation et des mouvements migratoires, l'État a perdu son enracinement dans une communauté politique relativement homogène sur le plan culturel. Le pluralisme moral et le multiculturalisme rendent problématique la définition de valeurs partagées par l'ensemble des citoyens. Les rapports entre les individus tendent dès lors à osciller entre une tolérante indifférence, rendue possible par l'absence de vivre-ensemble, et une incompréhension méfiante – voire une réelle xénophobie – génératrice, elle aussi, d'exclusion sociale.
Le pluralisme moral et le multiculturalisme ne seraient toutefois que des facteurs rendant plus complexe le maintien de la cohésion sociale par l'État, si cette fonction n'était pas plus profondément délégitimée sur le plan normatif par l'individualisme libéral. La primauté de l'économie sur le politique n'est, en effet, que la manifestation la plus visible de la prééminence culturelle de l'anthropologie individualiste propre au libéralisme.
Cette anthropologie est fondée sur le postulat, méthodologique voire ontologique, de la préexistence de l'individu à toute inscription dans des relations sociales et a pour corollaire la valorisation politique de la liberté comme indépendance dont Benjamin Constant (1980) estimait qu'elle était la liberté des Modernes. Alors que la conception antique de la liberté identifiait celle-ci à la participation politique, garante de l'absence de soumission à un pouvoir sur lequel on n'a pas de prise,l'individualisme
libéral voit dans l'homme libre celui dont l'arbitre est préservé de toute contrainte. Être libre, ce serait pouvoir agir selon ses préférences sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la valeur ou la raisonnabilité de celles-ci, et se voir garantir une sphère privée au sein de laquelle personne, pas même l'État, ne peut faire ingérence (Renaut, 1989).
Si les origines philosophiques de l'individualisme libéral remontent à trois siècles, il a pu devenir la référence culturelle dominante au cours de la seconde moitié du xxe siècle grâce à l'aboutissement du processus de sécularisation et en réaction au phénomène totalitaire. La réflexion de Constant, déjà, était motivée par la volonté de préserver l'aspiration émancipatrice portée par la Révolution française de la perversion de celle-ci dans le régime de la Terreur. Similairement, le fascisme et le communisme ont conditionné l'appréhension du politique depuis soixante ans. Comme Gauchet le soulignait : « Réfléchir sur la politique aujourd'hui, ce doit être réfléchir d'abord sur l'État totalitaire. » (Gauchet, 1976, 2005 : 433) Plus globalement, c'est l'indépendance de chaque individu par rapport à tout ordre transcendant, qu'il soit social, politique ou religieux, que l'individualisme libéral entend affirmer. L'individu est supposé se découvrir libéré de tout déterminisme. Son identité et sa valeur doivent dépendre de ses seuls choix et son aspiration est restreinte à la satisfaction de ses préférences personnelles, grâce notamment au système de la représentation politique qui lui permet d'être libéré de la nécessité de participer aux affaires publiques.
L'individualisme libéral trouve ainsi sa source dans un idéal émancipateur par rapport à tout déterminisme, mais son prix est la mise à mal du politique en tant que lieu de définition d'un projet commun. La volonté d'émancipation de l'individualisme est telle qu'elle déconstruit tout sentiment d'appartenance collective, toute ambition d'imaginer collectivement un futur qui soit la réalisation d'un idéal, d'un progrès. Cette incapacité collective est, selon l'expression de Bernard Stiegler (2006 : 14), « la misère politique » de notre temps, c'est-à-dire l'exact contraire de la prospérité politique. Elle restreint le vivre-ensemble au simple fait de la coexistence d'une pluralité d'individus sur un même territoire fini et à la nécessité de se partager les ressources naturelles (l'air, l'eau, etc.) comme artificielles (l'argent, les routes, etc.).
2. La réduction du politique à la gouvernance
Sa marge de manoeuvre restreinte dans les faits et sa mission d'institution d'une identité collective contestée normativement, quelle fonction conserve le politique ? Essentiellement, une fonction de gouvernance. Thème à la mode, la gouvernance exprime par excellence la disqualification du politique en tant que lieu d'élaboration d'un projet commun au profit d'un impératif de gestion pragmatique des ressources et des conflits. Plutôt que d'incarner une vision politique de la société, le politique doit être capable, dossier après dossier, de trouver un compromis pragmatique entre les intérêts en présence, de préserver l'ordre et de garantir la compétitivité économique.
Selon la logique de l'individualisme libéral, la liberté d'un individu ne doit être limitée que de l'extérieur par la liberté des autres individus, conformément à l'adage populaire voulant que « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». L'État est un instrument auquel il faut recourir pour garantir cette limitation mutuelle des libertés lorsque celle-ci n'est pas assurée spontanément. Il est un mal nécessaire afin que soit garantie une coexistence pacifique au sein de la société.
La logique individualiste est commune au néolibéralisme et au libéralisme de gauche qui inspire la plupart des partis de gauche traditionnels. Ce qui distingue fondamentalement les libéraux de gauche des néolibéraux, c'est une confiance nettement moindre dans l'ordre spontané du marché qui les conduit à justifier un rôle plus étendu à l'État chargé de réguler les interactions privées et de compenser les déficiences d'un marché imparfaitement concurrentiel. Mais les rôles régulateur et redistributeur de l'État se voient contraints par l'impératif de compétitivité économique imposant aux libéraux de gauche la recherche d'un compromis entre efficacité et justice sociale. Ce compromis est légitimé philosophiquement par le recours au principe de différence de John Rawls (1987 : 234) selon lequel les inégalités sont justifiées lorsqu'elles permettent d'améliorer le sort des plus défavorisés6. En conséquence, l'accumulation des richesses en haut de l'échelle sociale peut s'avérer justifiée si elle est nécessaire pour favoriser le développement de l'activité économique rendant possible la création d'emplois et le financement de la sécurité sociale.
La réduction du politique au modèle de la gouvernance étant dominante tant à gauche qu'à droite, la légitimité du politique ne dépend désormais plus tant de la participation des citoyens à la formation d'une volonté collective portée par les institutions politiques que de l'efficacité dont font preuve les représentants politiques dans la gestion des ressources publiques, notamment en réduisant autant que possible les coûts liés au fonctionnement de l'État dont la charge pèse sur l'ensemble des citoyens (Vercauteren, 2007). La vertu première attendue des politiques est désormais la « bonne gouvernance » qui réunit sous un même vocable leur capacité de gestion et leur éthique entendue comme l'absence de confusion de l'intérêt de leurs mandants et de leur intérêt personnel.
L'importance prise par le thème de l'éthique en politique est fondamentalement inhérente à la logique de la gouvernance. D'une part, le modèle de la gouvernance, en assurant la professionnalisation de la fonction politique, fait de la gestion des affaires publiques un métier. Il crée ainsi une congruence entre la carrière privée du personnel politique et les affaires publiques au risque d'instaurer de manière permanente la collusion d'intérêts dénoncée. D'autre part, dans la mesure où ce modèle dévalorise l'opposition idéologique entre différents projets de société, la concurrence entre les représentants politiques porte essentiellement sur leur capacité de gestion. Leur éthique personnelle est, dès lors, d'autant plus importante que l'efficacité de leur gestion proprement dite est difficilement objectivable.
Comme l'exprime Jacques Généreux "on devient plus aisément un champion de la morale publique que du plein-emploi ".
Si l'efficacité de la gestion politique est difficilement objectivable, ce n'est toutefois pas en raison d'un défaut d'indicateurs. Le taux d'emploi, le niveau de l'inflation, l'équilibre du budget de l'État, et surtout la croissance du produit intérieur brut, sont des indicateurs privilégiés. Mais démontrer le lien entre l'évolution de ces indicateurs macroéconomiques et des politiques précises est un exercice particulièrement spéculatif. Un gouvernement peut, par exemple, profiter d'une embellie économique redevable des politiques mises en place par le gouvernement précédent ou, plus prosaïquement, d'une conjoncture internationale sur laquelle il n'a guère d'influence. En dépit de ces limites, le modèle de la gouvernance voit dans ces indicateurs économiques les mesures de la prospérité de la société. Ils constituent, à ce titre, la fin ultime à l'aune de laquelle la gestion politique est évaluée.
S'impose dès lors une conception de la prospérité restreinte à la seule abondance des ressources économiques (Généreux, 2008 : 329-343). C'est là une conséquence directe de l'individualisme libéral et de la réduction du politique au modèle de la gouvernance. À partir du moment où l'État est perçu comme un mal rendu nécessaire par le besoin de gérer la coexistence d'une pluralité d'individus contraints de se partager un ensemble de ressources finies, il apparaît naturel de chercher à supprimer la cause de cette nécessité : la rareté des ressources. L'individualisme libéral promeut par conséquent un modèle de développement orienté vers la production d'une abondance économique censée assurer à chacun la satiété de ses besoins et la réalisation de ses désirs de telle sorte que la source de la rivalité entre les individus s'estompe, les autres devenant ceux avec qui il est possible de coopérer en vue de produire l'abondance recherchée et d'atteindre la prospérité.
3. Dérégulation morale et colonisation économique
Cette réduction de la prospérité à l'abondance des ressources économiques est complétée normativement par l'exigence de la neutralité axiologique de l'État. Cette exigence s'oppose, sur le plan politique à tout le moins, à toute affirmation collective de valeurs susceptible de guider l'usage par les individus de leur liberté. Pour l'individualisme libéral, l'État doit garantir la coexistence des sphères privées, mais non se prononcer sur ce qu'il estime bien qu'il soit fait au sein de ces sphères, sous peine d'outrepasser son rôle et de menacer l'indépendance des individus. L'État doit se préoccuper du « juste », mais non du « bien »8. Cette distinction entre le juste – traiter de manière impartiale chacun en veillant au respect des droits fondamentaux que possède tout homme – et le bien – juger quelle manière de vivre est préférable et donc évaluer de manière différenciée les comportements individuels – préviendrait l'État libéral d'une dérive despotique qui le conduirait, parce qu'il privilégie une conception particulière de la vie bonne,
à légitimer la discrimination des autres modes de vie. Au contraire, si l'État doit intervenir sur le plan axio–logique, c'est afin de soutenir les cultures et modes de vie minoritaires et de les protéger de toute discrimination à leur encontre de la part des cultures majoritaires. À l'instar des individus, les cultures doivent pouvoir coexister pacifiquement au sein de la société. Il s'agit, en définitive, d'instaurer une forme de quasi-marché culturel en proposant aux individus une multiplicité de cultures et de conceptions du bien auxquelles ils pourraient choisir librement d'adhérer.
Il n'y a donc pas de place, à l'échelle de la communauté politique, pour une recherche collective d'une prospérité incluant une forme de développement culturel ou moral, une interrogation sur les valeurs constitutives d'une vie bonne. Cette recherche est renvoyée aux limites de la sphère privée et d'une éventuelle socialisation au sein de communautés sociales, culturelles ou religieuses qui ont cependant été fortement affaiblies par le pluralisme et la sécularisation induite par le processus de modernisation.
L'exigence de neutralité de l'État porte un idéal émancipateur auquel il est difficile de ne pas souscrire. Dans une société dominée par la tradition et la conformité sociale, cet idéal constitue d'ailleurs la source d'un authentique progrès social. La déconstruction des valeurs traditionnelles qui a symboliquement triomphé depuis Mai 68 est certainement positive. Il est étrange néanmoins que, à gauche notamment, on ne semble pas s'inquiéter de son curieux parallélisme avec la dérégulation économique. L'une comme l'autre reposant sur la même consécration d'une liberté strictement individuelle, sur la même fiction d'un individu indépendant, ne doit-on pas craindre que ces deux logiques parallèles produisent des effets similaires ? Si la dérégulation économique ne profite pas à tous, la dérégulation morale sert-elle réellement l'autonomie personnelle ?
La justification de la croissance économique est supposée être la production de ressources, sans cesse plus importantes, afin de permettre aux individus de satisfaire leurs préférences, sans que les mécanismes économiques n'aient d'influence sur ces préférences. Pourtant, le développement de l'économie capitaliste s'est accompagné d'une transformation des valeurs sociales. De la même manière que l'éthique protestante a favorisé le développement du capitalisme naissant en valorisant l'accumulation de richesses (Weber, 1967), le capitalisme contemporain s'appuie sur un hédonisme matérialiste, privilégiant la jouissance immédiate de biens de consommation (Bell, 1979).
Consommer semble aujourd'hui constituer à la fois un devoir et une valeur : un devoir afin de contribuer à l'indispensable croissance dont se nourrit notre modèle économique et une valeur dans la mesure où, le libéralisme réduisant la vie en société à la coopération pour la production de ressources, la possession et la consommation de celles-ci constituent le critère privilégié de la reconnaissance sociale. L'enjeu est de construire un imaginaire suscitant un désir de consommation perpétuel (Stiegler, 2005 : 110-111). Le caractère aliénant
d'une économie de consommation apparaît ainsi dans la nécessité de maintenir l'individu dans son état d'insatisfaction en lui faisant miroiter la possibilité de la satisfaction de ses désirs au travers de la possession ou de la consommation d'un produit donné (Arnsperger, 2005 ; de Briey11, 2007 : 460-468). Un tel processus repose sur la colonisation économique de la culture.
Comme Habermas le met en évidence dans l'ensemble de son oeuvre, un processus de colonisation consiste dans l'expansion des principes de développement d'un système donné vers un autre système (de Briey, 2009a : 159-164). La colonisation économique de la culture signifie donc que le développement du système culturel, reprenant l'ensemble des croyances, normes, valeurs, modes de vie, etc., partagés par une collectivité, est déterminé par les impératifs de rentabilité et de profit propres au système économique. Or, suite à l'affaiblissement des sources classiques des normes sociales, comme la famille et l'école, les institutions qui possèdent désormais un pouvoir effectif de définition et de diffusion des normes sociales sont les médias de masse et tout particulièrement la télévision. Il n'est pas nécessaire de forcer le trait pour estimer que le poste de télévision – et plus généralement l'ensemble des médias de masse – a désormais pris la place du prêtre montant en chaire.
Cette substitution, loin d'être anodine, me paraît perverse dans la mesure où, à la différence du prêtre dont on pouvait présumer la sincérité, les médias de masse ont très explicitement une finalité commerciale.
Même une télévision publique, pour d'évidentes raisons budgétaires, ne remplit plus que subsidiairement une mission de service public – c'est-à-dire une mission visant à instruire le téléspectateur et non seulement à le divertir – et doit adopter une logique commerciale, sous peine de cesser d'être un média de « masse ». Ce sont les réalisateurs de cinéma – dont on sait qu'ils sont subsidiés pour intégrer dans leurs films telle marque de voitures, tel type de boissons, etc. –, les directeurs du marketing, les créatifs publicitaires, sans même parler des concepteurs de jeux vidéo, qui forgent les consciences collectives et façonnent les représentations de ce qui constitue une vie réussie.
C'est précisément cette subordination aux impératifs économiques qui est constitutive de la « colonisation » du culturel par l'économie. Cette colonisation induit un glissement d'une économie de marché vers une société de marché, c'est-à-dire une société dont l'ensemble des sous-systèmes est régi par les principes de développement propres au marché. L'individualisme libéral, en voulant préserver l'autonomie individuelle de l'interférence étatique, empêche de faire de la construction de référents collectifs authentiques un objet essentiel du politique et, ce faisant, il soumet les individus à une forme de despotisme économique. La dérégulation morale paraît dès lors être en définitive moins favorable à l'autonomie individuelle qu'au marché.
4. De l'indépendance à la responsabilité
L'individualisme libéral semble ainsi se situer à l'intersection du triptyque suivant :
– réduction de la prospérité au seul bien-être matériel ;
– réduction de l'État à un instrument de gestion de la coexistence des libertés individuelles ;
– légitimation de la recherche de la satisfaction des préférences individuelles.
Ces trois éléments renvoient au même idéal d'un individu préservé des interférences des autres individus et pouvant vivre conformément à sa propre conception du bien sans avoir à justifier celle-ci – du moins tant qu'elle est compatible avec la même liberté-indépendance des autres individus. Mais l'adoption d'un modèle de développement restreint à la seule prospérité matérielle favorise la colonisation de la culture par l'économie, tandis que la réduction de l'État au modèle de la gouvernance creuse l'abîme entre les citoyens et des représentants politiques auxquels ils ne s'identifient plus. Enfin, avoir dit aux individus qu'ils pouvaient ne se préoccuper que de ce qu'ils pensaient être leur intérêt personnel constitue l'une des sources de la récente crise économique et financière.
Souligner le déficit de régulation des marchés, tout particulièrement des marchés financiers, au terme de trente années de dérégulation néolibérale et en faire l'origine de la crise, c'est méconnaître que la dérégulation néolibérale est un processus moral avant d'être économique et financier. Plus encore que de démontrer le caractère autodestructeur d'un modèle de développement basé sur la recherche d'une croissance infinie dans un monde fini et ne prenant pas en compte les coûts environnementaux et sociaux générés par nos modes de production et de consommation, la crise me semble illustrer combien la légitimation libérale de la recherche par les individus de la seule satisfaction de leurs préférences personnelles constitue une escroquerie philosophique.
Or, l'espoir que le système économique et financier puisse être fortement régulé par l'État et que la répartition des richesses soit revue en profondeur se heurte à une double limite. Premièrement, la périphérisation de l'État, décrite plus haut, restreint sa marge de manoeuvre, de telle sorte que seule une coopération internationale paraît à même d'imposer une régulation efficace. Deuxièmement, dans un contexte de dévalorisation du politique et de légitimation de la poursuite individualiste de leur intérêt personnel, la compliance des citoyens est fragilisée. La logique individualiste n'incite pas les citoyens à respecter volontairement les lois lorsqu'il leur est possible de les enfreindre sans être sanctionnés. Elle favorise au contraire le parasitisme : une reconnaissance officielle des normes en vigueur doublée d'une volonté de s'en affranchir personnellement. Seul un État capable d'assurer un régime répressif extrêmement fort est capable de rendre rationnelle, du point de vue individualiste, la conformité inconditionnelle à la loi. Ce qui n'est, aujourd'hui, ni possible ni souhaitable.
La main de fer de l'État n'ayant pas, fort heureusement, la rigidité nécessaire, elle n'est pas davantage en mesure, que la main invisible du marché, de rendre la poursuite individualiste des intérêts personnels durablement conforme à l'intérêt général. Il s'agit dès lors de remonter à la source de la crise financière et économique, comme des crises sociales et politiques, et de rompre avec la logique de l'individualisme. L'enjeu consiste à percevoir que les crises actuelles sont aussi une crise de valeurs, dans la mesure où tout le monde a, à un degré ou à un autre, été contaminé par l'idéologie individualiste. Tout le monde a, à un degré ou à un autre, désappris à voir au-delà de son intérêt personnel immédiat. Les décideurs politiques, mais aussi les acteurs économiques et les simples citoyens, doivent prendre conscience que vivre en société, ce n'est pas seulement vivre les uns à côté des autres en recherchant chacun la satisfaction de ses préférences personnelles. À la valorisation individualiste de l'indépendance, il faut substituer la qualité d'une interdépendance (Généreux, 2008 : 438-440) entre des personnes soucieuses de prendre en compte les effets à long terme de leurs actes et conscientes de la responsabilité qu'elles ont les unes envers les autres.
Cela implique de rompre avec la conception de la liberté comme « indépendance » au profit d'une définition de la liberté comme « autonomie » (de Briey, 2009a : 38-42). Conformément aux principes de la morale kantienne dont elle s'inspire (Kant, 1985, 1994), la liberté comme autonomie consiste dans le fait de se donner à soi-même des principes d'action dont on peut vouloir qu'ils soient universalisés. Pour l'essentiel, cela implique que la liberté, outre sa limite externe, reçoive également une limitation interne : la volonté d'agir conformément à ce que l'on estime bien, non seulement pour soi, en fonction de ses intérêts personnels, mais selon des valeurs universelles. Qu'il existe ou non de telles valeurs, que les devoirs et obligations qui en découlent soient ou non connus, n'est pas ici pertinent. Ce qui importe, c'est la volonté de chaque acteur de se conformer à l'idée de telles valeurs et d'adopter des comportements qu'il juge compatibles avec celles-ci, indépendamment de la validité de son jugement singulier et du consensus social existant ou non sur cette validité. Le point de rupture avec l'individualisme réside donc dans l'indissociabilité de l'exercice de la liberté et du sentiment de responsabilité morale de l'individu conscient que son comportement interagit avec celui des autres personnes.
À vrai dire, tant que l'on en reste là, un partisan de l'individualisme libéral pourrait considérer une telle exigence compatible avec sa conception du politique. Il pourrait concéder que, sur le plan moral, il est souhaitable que l'individu privilégie une conception de la liberté comme autonomie plutôt que comme indépendance, mais maintenir que, sur le plan politique, l'État ne doit se préoccuper que de garantir une juste coexistence des indépendances individuelles. C'est, toutefois, méconnaître qu'un appel à la prise de conscience de notre responsabilité collective n'a de sens d'être entendu qu'au sein d'un ethos social qui ne réduit pas le vivre-ensemble à la seule coopération en vue de la production de ressources matérielles, mais qui place en son centre le questionnement sur notre responsabilité morale.
Si un grand nombre d'individus estiment aujourd'hui légitime de ne se préoccuper que de leurs intérêts personnels, c'est parce que la culture ambiante est dominée par la logique individualiste. Si un grand nombre d'individus voient actuellement dans la prospérité matérielle un vecteur privilégié de reconnaissance sociale, c'est parce que la recherche de la prospérité économique est le principal, lorsqu'il n'est pas l'unique, projet commun à l'ensemble de la société. Similairement, c'est dans la mesure où la société placera au coeur de son projet de développement – et donc de sa définition de la prospérité – la volonté de vivre de manière non seulement confortable, voire juste, mais aussi conformément au bien, qu'il sera possible de rompre avec l'individualisme moral. C'est dans la mesure où la société valorisera davantage le fait d'agir en prenant en compte les effets à long terme de ses actions et leurs conséquences pour les autres personnes, que chacun sera incité à s'interroger sur la légitimité de ses préférences personnelles. C'est, en outre, le sentiment d'appartenance à une même collectivité qui peut créer, entre les membres de celle-ci, l'empathie les disposant à subordonner la maximalisation de leurs intérêts personnels à leur responsabilité morale.
L'indissociabilité entre réflexion individuelle et interrogation collective sur la responsabilité morale est, en outre, confortée par un argument épistémologique. Un individu ne réfléchit pas sur les valeurs constitutives d'une vie bonne de manière solipsique. Il ne peut parvenir à dépasser les limites de sa perspective particulière qu'en confrontant son point de vue à ceux exprimés au sein d'une délibération intersubjective. Même si, ultimement, c'est à chaque fois un sujet donné qui doit assumer la responsabilité du jugement qu'il énonce en prenant position, de manière éventuellement critique, par rapport à la délibération collective, il ne peut construire progressivement sa réponse personnelle qu'en inscrivant celle-ci dans une réflexion collective (de Briey, 2006).
Ce faisant, c'est la signification du rapport entre les individus qui est transformée. Les autres ne sont plus seulement vus comme ceux qui restreignent la liberté de l'individu, avec lesquels il est tout au plus possible de coopérer lorsque les intérêts sont convergents. Les autres sont désormais considérés comme rendant possible la liberté de chaque individu en étant ceux par rapport auxquels il se positionne. Ils forment une communauté au sein de laquelle chacun occupe une place singulière. La logique individualiste est ainsi complètement retournée. L'affirmation de soi est indissociable d'un sentiment d'appartenance collective qui doit se construire autour d'un projet de développement commun. Si celui-ci peut toujours être compris comme la recherche de la prospérité, la définition de la prospérité recherchée au travers du développement social est profondément transformée. La prospérité recherchée n'est plus seulement matérielle ou économique. Elle est également morale.
5. Une définition politique de la prospérité
Le terme « prospérité » n'est guère aisé à définir, pointais-je en introduction, avant d'en proposer une définition formelle comme « finalité du développement ». Cette définition fait de la prospérité l'objectif du progrès social, mais elle ne nous dit rien sur le type de développement et de progrès concerné. J'ai au contraire récusé une définition plus substantielle de la prospérité restreignant celle-ci à un état d'abondance matérielle, voire économique. L'ambition conjointe à l'ensemble des contributions de cet ouvrage de « redéfinir la prospérité » ne peut se limiter à une évaluation technique des mérites et faiblesses des indicateurs de développement. Elle comporte une interrogation plus large sur le type même de développement et de progrès social – donc de prospérité – que nous pensons souhaitable de promouvoir.
La réponse à une telle interrogation ne relève pas, cependant, d'une expertise scientifique. C'est au contraire dans la possibilité, pour une communauté politique, de faire sienne cette interrogation que peut s'enraciner un sentiment d'appartenance et d'identité collective. Dans le modèle de l'État-nation, ce sentiment d'appartenance était constitutif du patriotisme unissant une collectivité autour de valeurs communes. Ces valeurs communes étaient supposées fondées sur une race, une religion, une tradition ou une histoire partagées par l'ensemble des membres de la nation. L'individualisme libéral a, toutefois, brisé tout déterminisme social de ce type. À moins d'adopter une posture réactionnaire, nous ne pouvons par conséquent rompre avec l'individualisme libéral que si nous fondons l'appel à la responsabilité morale sur un sentiment d'appartenance à une communauté reposant sur la conviction de participer à un même projet défini et construit collectivement – non sur une identité donnée et indisponible.
Dans la mesure où l'autre n'est pas compris seulement comme celui avec qui nous partageons le même monde et dont la liberté limite la nôtre, cette recherche collective de la prospérité ne peut se réduire à une coopération mutuellement intéressée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement de s'accorder sur le mode de production des ressources permettant de vivre les uns « à côté » des autres, mais bien de s'entendre sur la manière dont nous désirons vivre les uns « avec » les autres. Le projet commun, autour duquel peut prendre source un sentiment d'appartenance collective, ne doit pas être la recherche d'une prospérité restreinte à la création durable et à la répartition des ressources, mais bien s'étendre également aux fins poursuivies dans l'usage de ces ressources.
L'enjeu n'est pas, cependant, de verser dans le conservatisme en voulant imposer à la société un ensemble de valeurs données. Nous ne disposons ni d'une conception substantielle de la prospérité décrivant de manière déterminée l'état de développement recherché ni d'une conception morale substantielle. Aucune tradition, religion ou autre type de fondement hétéronome n'a la légitimité pour imposer des valeurs homogènes à l'ensemble de la société. Il s'agit donc au contraire de consacrer le pluralisme d'une société qui discute collectivement des valeurs qu'elle souhaite promouvoir. Ces valeurs n'auraient d'autre légitimité que celle de reposer sur le débat public et elles n'auraient de validité que le temps de leur remise en cause – remise en cause d'autant plus nécessaire que le débat public aura toujours été sous-tendu par des rapports de force entre intérêts contradictoires. La déconstruction sociale des idéologies dominantes et la reconstruction collective de valeurs partagées doivent ainsi constituer deux moments indissociables d'un même processus. L'essentiel n'est pas de réaffirmer des valeurs précises, mais bien de redonner une place aux valeurs dans le débat public. Le fait de s'interroger sur le bien-fondé de nos actes est bien plus important que la réponse, toujours discutable, que nous y apportons.
6. Vers une prospérité politique ?
Alors que l'individualisme libéral fait du politique un instrument de gestion de la coexistence des arbitres individuels, le sens proprement démocratique du politique consiste, selon moi, dans l'action de la collectivité sur elle-même afin de construire la société dans laquelle elle souhaite vivre. Les institutions politiques doivent être le lieu où se formalise le débat social et où se définit explicitement, et se redéfinit continuellement, la prospérité recherchée collectivement.
Une telle appréhension du politique, d'inspiration républicaine, s'efforce de prendre acte de la périphérisation de l'État. Elle repose sur une schématisation en trois stades du développement de l'État moderne :
1) La figure de l'État-nation, caractérisée par la souveraineté de l'État et l'homogénéité de la nation. Cette figure est propre à des sociétés relativement fermées sur elles-mêmes.
2) La figure de l'État gestionnaire, conforme au modèle de la gouvernance, devant assurer la coexistence des libres arbitres et favoriser la production économique. Cette figure s'impose suite à la globalisation économique et à l'interdépendance croissante entre États.
3) La figure de l'État participatif, caractérisée par sa capacité à exprimer formellement une volonté collective et par le fait que les citoyens se reconnaissent dans leurs institutions.
La première figure est marquée par l'héritage de l'absolutisme monarchique des xviie et xviiie siècles. Elle voit en l'État une force capable, en raison du pouvoir de contrainte que lui confère le monopole de la violence légitime, de régir de manière déterminante les rapports sociaux au sein d'une société relativement bien protégée des interférences extérieures. À la lumière des expériences totalitaires du xxe siècle, l'enjeu philosophique posé par une telle figure de l'État est celui de la limitation du pouvoir de l'État. L'idée démocratique y joue dès lors un rôle essentiel, mais principalement restreint au contrôle de l'appareil étatique par les citoyens via, notamment, les mécanismes électoraux. Ce contrôle permet de préserver la conviction que la collectivité est capable, à travers l'État, d'agir librement sur elle-même.
La deuxième figure apparaît comme une forme résiduaire de la première suite à la périphérisation induite par la mondialisation. L'État demeure essentiellement vu comme un instrument de contrainte, mais l'inscription sans cesse plus forte des sociétés dans une interdépendance globale le prive de sa souveraineté. C'est la figure d'un État qui, parce qu'il subit sa périphérisation plutôt que d'en tirer les conséquences, est en crise dans chacune de ses fonctions principales.
La troisième figure, au contraire, déduit de cette périphérisation la caducité d'une caractérisation de l'État par la capacité de contrainte. La mobilité inhérente à la mondialisation subordonne, conditionne, au moins partiellement, le pouvoir de contrainte de l'État à la compliance des citoyens. À partir du moment où une partie essentielle de ceux-ci a la possibilité de s'affranchir de l'emprise d'un État donné, ce dernier n'est plus à même de régir les rapports sociaux que dans la mesure où les citoyens acceptent volontairement de se soumettre à sa loi. Dès lors que l'État est réduit à un prestataire de service, on entre dans une concurrence interétatique annihilant progressivement la capacité d'action du politique. Cette capacité d'action ne peut être retrouvée qu'en développant un sentiment d'appartenance à la communauté politique. Ce n'est plus dès lors le pouvoir de contrainte qui doit caractériser l'État, mais son aptitude à formaliser et à exprimer une volonté collective.
Le passage de la deuxième à la troisième figure repose par conséquent sur un enjeu grammatical – pronominal pour être plus précis. Nous devons réapprendre à
dire « nous ». Le schéma individualiste de la dissociation de la société et de l'État s'exprime dans la conscience collective par l'usage des pronoms « ils » et « eux » pour désigner les représentants politiques en les opposant au « nous » de la société civile. La représentation y est d'ailleurs conçue comme une délégation de la fonction de gestion des affaires publiques, permettant aux citoyens de se consacrer à la gestion de leurs affaires privées. Par contraste, la réussite de la figure participative du politique doit se manifester par l'usage d'un « nous » collectif intégrant l'État et les représentants politiques à la société civile et soulignant la responsabilité partagée par chacun vis-à-vis de la prospérité présente et future de la société. Participer, c'est avant tout s'intégrer dans une action de la collectivité sur elle-même.
La fonction du politique, en tant que lieu de formation et d'expression d'une volonté collective, est dissociable de tout pouvoir de contrainte. La force n'appartient nécessairement à l'essence du politique que lorsque celui-ci est assimilé à un instrument devant pallier la faiblesse des volontés. Lorsque la finalité du politique est de permettre l'expression d'une volonté collective – et de formaliser cette expression au travers de ses institutions –, il n'y a aucune nécessité à doubler systématiquement l'affirmation de cette volonté d'un dispositif contraignant en imposant le respect à tout individu. L'expression d'un jugement collectif étant une fin en soi, la volonté de le rendre contraignant apparaît comme une question distincte. L'affirmation d'une norme collective doit être perçue comme un référent rendant possible la prise de position individuelle, non comme une contrainte venant limiter la liberté individuelle. Dans une société mondialisée, le respect des normes est, de toute façon, bien davantage assuré par l'adhésion que par la menace d'une sanction. C'est pourquoi, pour l'exprimer de manière imagée, la figure représentative de l'État au xxie siècle ne peut plus être le fonctionnaire appliquant un règlement contraignant, mais bien les parlementaires en train de débattre. La société doit avoir l'impression de débattre à travers ses représentants.
Conclusion
En réinvestissant le politique comme le lieu où est débattue collectivement la définition de la prospérité recherchée à travers notre modèle de développement sociétal, l'on rompt avec la logique de l'individualisme libéral et l'on affirme la fonction de socialisation du politique – c'est-à-dire de création d'une société de personnes vivant non seulement les unes à côté des autres, mais surtout les unes avec les autres et engagées dans des relations de communication et de reconnaissance autour d'une histoire et d'un projet communs.
Alors que l'absence de projet commun – constitutive, selon Bernard Stiegler de «la misère politique » de notre temps – rend impossible la mobilisation de la société au profit de l'invention de notre avenir, l'appréhension du politique comme capacité de la collectivité d'agir sur elle-même – à vrai dire, il s'agit d'une
capacité tant de réflexion que d'action collectives –, permet de promouvoir un nouveau développement politique, conforme au contexte de la mondialisation et de la périphérisation de l'État qu'elle induit. En plaçant la question d'une définition de la prospérité au coeur du débat politique est réaffirmée l'importance de la fonction, actuellement délégitimée, de renforcement de la cohésion sociale du politique. Elle en constitue même la fonction première dans la mesure où elle apparaît constituer une condition favorisante – à défaut d'une condition strictement nécessaire – à la réalisation des autres fonctions politiques. Un sentiment d'appartenance sociale construit autour d'un projet commun ne peut que contribuer à des relations sociales paisibles et au respect de lois. Une délibération collective autour d'une conception élargie de la prospérité ne peut que fragiliser la prééminence de l'économique et favoriser la réaffirmation de la primauté du politique.
À l'inverse de la dévalorisation présente du politique, la réussite du développement politique promu s'exprimerait dans le fait que les citoyens se reconnaissent dans leurs institutions et leurs représentants, ainsi que dans le fait qu'ils jugent adéquat l'exercice par le politique de ses fonctions, dont, au premier titre, le renforcement de la cohésion sociale autour d'une définition de la prospérité socialement recherchée. Par opposition à l'expression de Stiegler, un tel niveau de développement politique serait constitutif d'une prospérité politique. C'est pourquoi la recherche d'une définition politique de la prospérité participe à la prospérité politique.
Bibliographie
Ackerman Bruce (1980), Social Justice in the Liberal State, Yale University Press, New Haven and London.
Arnsperger Christian (2005), Critique de l'existence capitaliste. Pour une éthique existentielle de l'économie, Cerf, Paris.
Beck Ulrich (2006), Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?, Aubier, Paris.
Bell Daniel (1979), Les Contradictions culturelles du capitalisme, PUF, Paris.
Constant Benjamin (1980), De la liberté des Modernes, Le Livre de poche, Paris.
de Briey Laurent (2006), Le Conflit des paradigmes, éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles.
de Briey Laurent (2007), « Une économie authentique ? Entre libération et sublimation du désir », Revue philosophique de Louvain, n° 105, vol. 3, p. 460-468.
de Briey Laurent (2009a), Le Sens du politique, Mardaga, Wavre.
de Briey Laurent (2009b), « Aux sources philosophiques de la crise », Places to be, juin, p. 10-13.
Gauchet Marcel (2005), « L'expérience totalitaire et la pensée politique », in La Condition politique, Gallimard, Paris, publié initialement dans la revue Esprit, dans le numéro 7-8 de juillet-août 1976.
Généreux Jacques (2008), La Dissociété, Seuil, Points, Paris.
Habermas Jürgen (1987), Théorie de l'agir communicationnel, Fayard, Paris.
Habermas Jürgen (1988), L'Espace public, Payot, Paris.
Kant Emmanuel (1985), Critique de la raison pratique, Gallimard, Folio, Paris.
Kant Emmanuel (1994), Métaphysique des moeurs. I. Fondation, Introduction, Flammarion, Paris.
Rawls John (1987), Théorie de la justice, Seuil, Paris.
Rawls John (1993), « La priorité du juste et les conceptions du Bien », in Justice et Démocratie, Seuil, Paris.
Rawls John (1999), The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Renaut Alain (1989), L'ère de l'individu, Gallimard, Paris.
Stiegler Bernard (2005), Constituer l'Europe. 1. Dans un monde sans vergogne, Galilée, Paris.
Stiegler Bernard (2006), La Télécratie contre la démocratie, Flammarion, Paris.
Vercauteren Pierre (2001), « La crise de l'État dans l'Union européenne », Annuaire français de relations internationales, II.
Vercauteren Pierre (2007), « Gouvernance et démocratie : quel ordre ? », in Fédéralisme Régionalisme, vol. 7, n° 2 : Société civile, globalisation, gouvernance : aux origines d'un nouvel ordre politique ?, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=591
Weber Max (1967), L'éthique protestante et l'Esprit du capitalisme, Plon, Paris.
''Prospérité et crise politique'', paru dans l'ouvrage Redéfinir la prospérité, sous la direction d'Isabelle Cassiers

